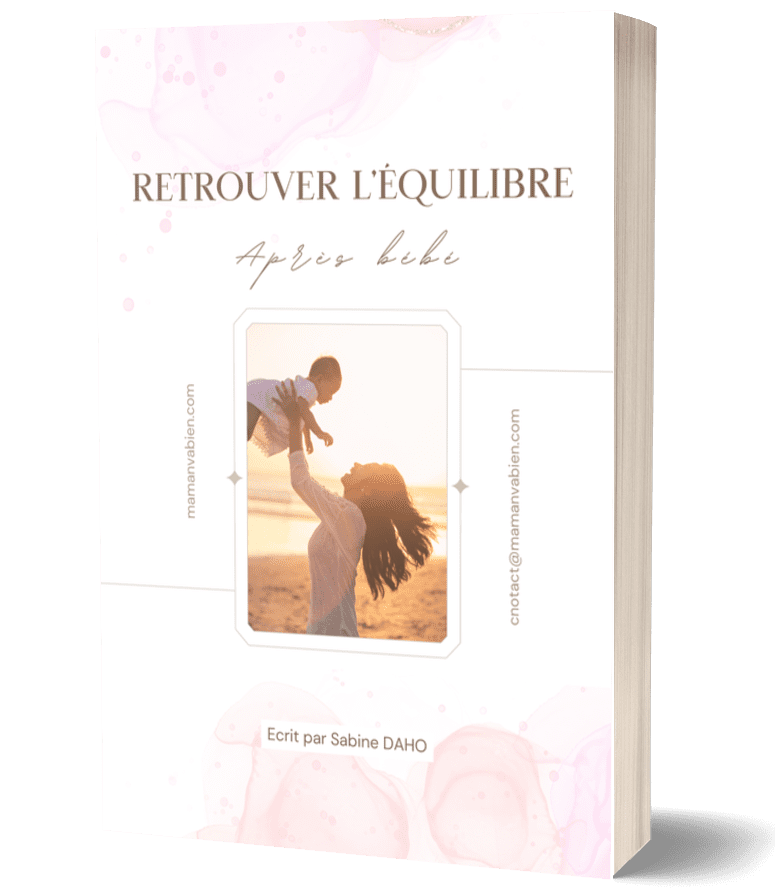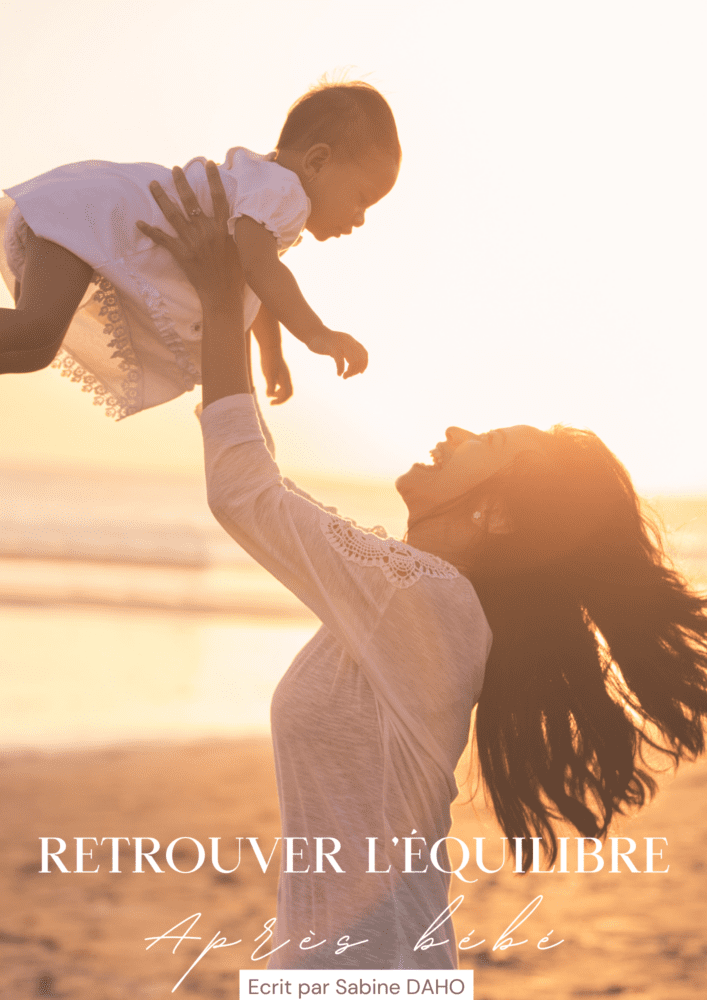Vers un parcours médical plus serein
Si vous avez lu mes deux derniers épisodes sur la médicalisation progressive de la maternité et les violences gynécologiques et obstétriques courantes, vous vous demandez peut-être comment faire pour changer la situation. En tout cas, c’est ce que je me suis demandé en rédigeant tout cela : comment aider les futures mamans à aller vers un parcours médical plus serein ? Car si ce site existe, c’est parce que je suis convaincue qu’il existe un moyen d’améliorer l’expérience de la maternité pour toutes.
Dans cet article, je vais donc discuter avec vous des différentes pistes de réflexions que j’ai ouvertes.
Des violences parfois involontaires
En 2020, la sage-femme Anna Roy a partagé un témoignage sous le hashtag #jesuismaltraitante. Dans ce témoignage, elle exprime à quel point les conditions de travail l’ont amenée à devenir maltraitante malgré elle.
C’est une situation de détresse réelle dans laquelle nos professionnels de santé sont plongés à cause des contraintes de moyens et de rentabilité qui pèsent aujourd’hui sur notre système de santé.
Il est important de comprendre qu’une des sources principales de ces maltraitances vient souvent de cet effet domino, plutôt que d’une volonté d’être violent.
Il faut rester consciente que dans cette lutte contre la violence, ce n’est pas nous contre eux, les mamans contre les professionnels de santé. C’est tout le monde contre une situation absurde qui met chacun d’entre nous dans des situations de violences subies et transmises malgré nous.
Ouvrir les yeux sur cette situation est un premier pas nécessaire pour que la situation puisse changer.
Pour en savoir plus, je vous invite à lire cet article sur Brut, avec un message d’Anna Roy adressé directement à M. le Président de la République.
Reconnaître les signes de violences
La violence peut être présente sous forme verbale (humiliations, insultes même à demi-mots, communication inadéquate) ou sous la forme d’actes (non respect du consentement, négligence des besoins émotionnels). Dans tous les cas, il est important que cela vous mette la puce à l’oreille : ce n’est pas parce que vous êtes face à des professionnels qu’ils ont le moindre droit ou pouvoir sur vous.
Ils ont le devoir de vous informer, de vous accompagner pour que vous puissiez exercer votre jugement et prendre vous-même les décisions de façon libre et éclairées, comme l’indique la loi Kouchner de 2002.
Quoiqu’il arrive, c’est votre corps, votre intimité, votre grossesse et votre accouchement. Même s’il est évident qu’ils sont plus compétents que nous, cela signifie qu’ils doivent vous aider et vous informer. Cela ne signifie absolument pas qu’ils ont le droit de prendre des décisions à votre place, ou de vous faire croire que vous n’êtes pas en position de décider (que ce soit on vous rabaissant ou en vous faisant douter de vous).
Si jamais vous vous sentez mal à l’aise, blessée, gênée, écoutez-vous. Ecoutez votre ressenti. Vous avez parfaitement le droit de demander à votre praticien de respecter vos choix, et si vous voyez que rien ne change, vous pouvez à tout moment changer de praticien. N’ayez aucun regret à ce sujet : vous n’avez aucun engagement contractuel à rester chez un praticien qui ne vous fait pas vous sentir en sécurité. Votre bien-être et votre intégrité physique et mentale sont votre priorité !
Le pouvoir de la connaissance
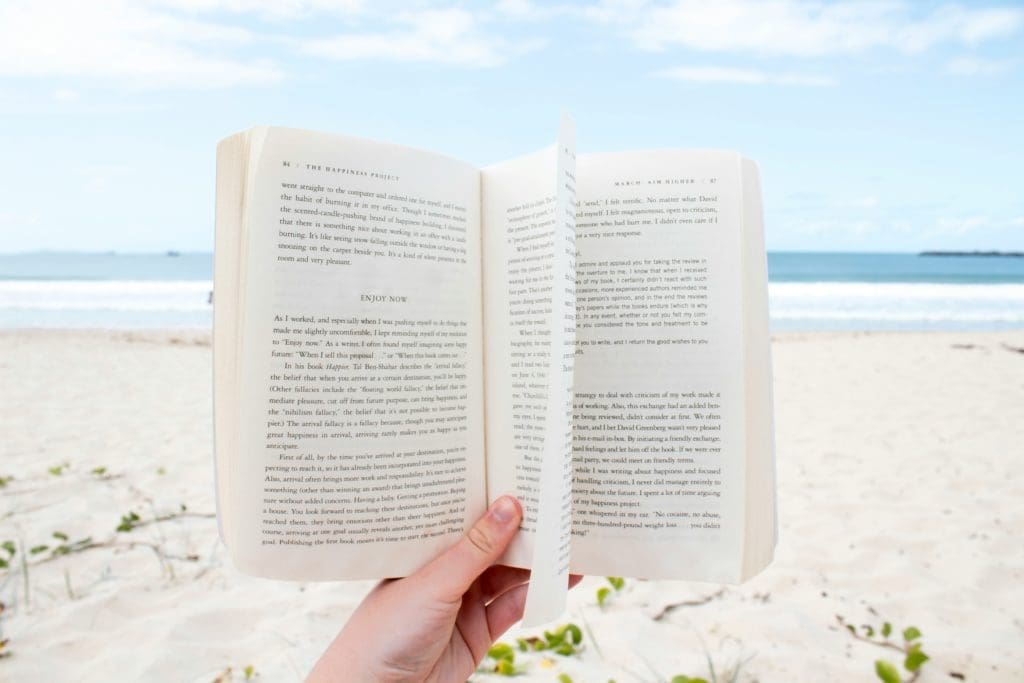
La plupart des problèmes rencontrés par les mamans lors de leur expérience de la maternité vient du manque d’information. Elles ne savent souvent pas à quoi s’attendre. Certaines sont confiantes dans les mythes qui entourent la maternité (l’instinct naturel, le fait que la maternité est vieille comme le monde et donc totalement « naturelle », sans tenir compte des changements profonds de notre société et de notre système médical). D’autres encore n’osent pas poser leurs questions, soit à leur entourage, soit aux professionnels qui les entourent. Peut-être parce qu’elles ne se sentent pas légitimes face à des personnes qui manquent de tact ou d’écoute ? Peut-être parce qu’on essaie de les persuader qu’elles devraient déjà tout savoir et que poser des questions vient à remettre en question une « évidence » ?
J’invite toutes les mamans à ne pas rester seules avec leurs questions. Si vous n’êtes pas à l’aise pour en parler avec votre gynécologue, parlez en avec vos amies qui sont déjà mamans, ou avec votre sage-femme. Si vous avez peur de ne pas trouver l’écoute qui vous convient, n’hésitez pas à vous renseigner sur internet sur des sites de confiance.
Par exemple, le site 1000-premiers-jours.fr a été mis en place par le gouvernement pour accompagner les futurs et jeunes parents.
Si vous en avez les moyens, je ne peux que vous recommander l’application « May », dans laquelle vous disposez de beaucoup d’articles très instructifs, mais aussi d’un accès privilégié à toute une équipe de professionnels à votre écoute.
J’espère aussi que ce site mamanvabien.com sera l’un de vos alliés pour construire une expérience de maternité informée et pro-active.
En ayant de meilleures connaissances des options qui s’offrent à vous, vous serez plus autonome pour vivre une maternité qui vous ressemble. Une expérience que vous pourrez vivre pleinement et sereinement.
Le projet de naissance
Le projet de naissance est un document simple, coconstruit avec votre sage-femme et votre partenaire, dans lequel vous préparez votre accouchement en mettant noir sur blanc vos préférences et vos souhaits. Le fait de construire ce document vous encourage à vous renseigner et à vous informer sur les pratiques autour de la naissance et sur vos droits.
Le fait de le construire avec votre sage-femme permet d’intégrer les contraintes éventuelles liées à votre lieu d’accouchement : par exemple, dans mon CHU, je ne pouvais pas emporter ma propre nourriture, alors que j’avais le souhait de pouvoir grignoter des fruits secs pendant que mon col travaillait. Il est donc important de mettre en parallèle vos souhaits et les possibilités offertes par la structure qui va vous accueillir.
C’est un projet qu’il est important de construire à deux, car votre partenaire est partie prenante de cette aventure et vous sera d’une aide extrêmement précieuse le jour venu. Si votre partenaire partage votre projet, il ou elle sera en mesure de le soutenir lorsque votre esprit et votre corps seront pris par le travail de naissance.
Je vous invite à utiliser le site Mon Projet de Naissance : il est extrêmement bien fait, dispose de plein d’options qui vous permettront d’ouvrir la discussion et de poser des questions aux professionnels qui vous entourent pour vous préparer.
Où trouver de l’aide

Si jamais vous vous trouvez face à une situation de violence gynécologique ou obstétricale, voici quelques façons de le signaler et trouver de l’aide. Vous n’êtes pas obligés de rester seule face à cette situation.
Il existe plusieurs associations dont la mission est de vous écouter et de vous accompagner dans cette situation.
L’institut de recherche et d’actions pour la santé des femmes (IRASF) a pour objet de lutter contre ces violences spécifiques.
Vous pouvez les contacter via leur page facebook : https://www.facebook.com/AssoIRASF/
L’autre association très active sur ce sujet est StopVOG, que vous pouvez trouver également sur facebook : https://www.facebook.com/StopVOGfr
Si vous souhaitez dénoncer, signaler ou porter plainte pour une cas de violence gynécologique, voici une liste de guide pour vous aider :
- le guide du CIANE : https://ciane.net/infoparents/vecu-experience-difficile/
- le guide de la Fondation des Femmes : https://fondationdesfemmes.org/fondation/nos-publications/
- le guide du GIAPS (Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles) : https://asso-giaps.org/2022/02/16/guides-sur-les-violences-gynecologiques/
Je vous invite à consulter ces ressources même à titre informatif, car elles permettent de se préparer et d’éviter les situations de violences gynécologiques. Prévenir est toujours mieux que guérir, et c’est l’un des mots d’ordre de Maman Va Bien !
Et vous, avez-vous une expérience ou un conseil à partager ? N’hésitez pas à les partager en commentaires.