Pourquoi le “Mom Rage” est un tabou entretenu par le patriarcat
Tu ne sais même plus pourquoi tu as crié. Un jouet par terre ? Un body plein de caca juste avant de partir ? Une phrase anodine de ton partenaire qui a mis le feu aux poudres ?
Et maintenant, tu es là. Assise sur le carrelage de la cuisine, le cœur en vrac. Tu pleures. De fatigue, de honte, de solitude. Et surtout… de culpabilité.
Ce moment où tu perds le contrôle, tu sais qu’il ne définit pas qui tu es. Mais il te hante quand même. Parce qu’on ne t’a pas préparée à ça. Personne ne t’a dit que la colère maternelle existait. Et encore moins que c’était courant. Humain. Légitime.
On appelle ça le “Mom Rage”. Et spoiler : ce n’est pas toi le problème.
Le tabou autour de la colère des mères n’est pas un hasard. Il a des racines profondes, culturelles, sociales. Et tant qu’on continue à penser que “c’est une question de caractère”, on passe à côté du vrai sujet.
Dans cet article, on va secouer un peu les cadres :
👉 Pourquoi le mom rage dérange autant ?
👉 En quoi le patriarcat participe (activement) à le maintenir sous silence ?
👉 Et pourquoi en parler, c’est déjà un acte de résistance.
Spoiler : tu n’es pas seule. Et non, tu n’es pas folle.
C’est quoi, le “Mom Rage” (et pourquoi tu n’es pas une mauvaise mère)
Le “Mom Rage”, ce n’est pas juste une montée d’énervement parce que bébé a renversé sa purée sur ton chemisier blanc alors que tu étais déjà en retard (même si bon… ça compte aussi).
C’est une colère intense, brutale, souvent disproportionnée par rapport au déclencheur. Un truc qui te submerge, te fait crier plus fort que tu ne l’aurais cru possible… et qui, souvent, te laisse vidée, honteuse, paumée.

C’est ce moment où tu perds le contrôle alors que tu fais tout, tout le temps, pour justement tout garder sous contrôle. Ironique, non ?
“Je ne comprends pas ce qui m’arrive… Je n’ai jamais été quelqu’un de colérique. Mais là, je hurle. Je me fais peur.”
Tu sais quoi ? Cette colère-là, elle ne fait pas de toi une mauvaise mère. Elle fait de toi… une humaine sous pression.
Une humaine :
- épuisée physiquement (salut les nuits saccadées),
- sursollicitée émotionnellement (bonjour les pleurs incessants),
- isolée socialement (adieu les cafés entre copines),
- et confrontée à un rôle maternel sacrément exigeant, souvent sans réelle reconnaissance ni relai.
Bref, c’est le trop-plein. Et le mom rage, c’est ce qui déborde quand tu n’as plus d’espace pour respirer.
Il ne s’agit pas ici de cautionner la violence, évidemment. Mais de comprendre d’où ça vient. Et surtout, pourquoi c’est si tabou — alors que tant de mères le vivent.
Tu veux savoir pourquoi tu n’en as jamais entendu parler avant de taper “je crie sur mon bébé je suis un monstre” à 2h47 du matin sur Google ?
Spoiler : ce n’est pas un oubli. C’est un système.
Et ce système a un nom.
Pourquoi c’est un tabou ? (Spoiler : le patriarcat adore qu’on se taise)
Tu sais ce qui est fou ?
C’est qu’on parle (un peu) de baby blues, (un peu moins) de dépression post-partum… mais de la colère maternelle, quasiment jamais.
Comme si c’était la honte absolue.
Un truc tellement impensable qu’on préfère croire que ça n’existe pas. Ou que ça arrive seulement aux mères “instables”, “agressives”, “pas faites pour ça”.
Et pourtant, cette colère, elle est partout. Mais elle se vit en silence, dans les salles de bains, dans les voitures, dans les chambres à coucher fermées à clé.
Tu sais pourquoi ? Parce qu’on nous a bien conditionnées à ne jamais l’exprimer.
Parce que “bonne mère = douce, patiente, et reconnaissante”
L’image de la mère parfaite, tu la connais par cœur.
Toujours disponible, toujours calme, toujours prête à se sacrifier avec le sourire.
Un modèle hérité… devine de qui ? 👀
Oui, du patriarcat. Ce bon vieux système dans lequel :
- les femmes maternent,
- les hommes bossent,
- et les émotions trop puissantes sont priées de rester dans leur boîte (sauf si elles sont l’expression d’une virilité dominante, évidemment…)
Résultat : quand une mère ose ressentir de la colère, elle se heurte à une double peine :
- On lui dit (directement ou non) que c’est “pas normal”.
- Elle l’intègre… et se juge elle-même.
La colère féminine dérange. La colère maternelle, c’est pire.
On ne veut pas voir des mères en colère.
On préfère les voir épuisées mais souriantes, débordées mais polies, au bout du rouleau… mais “tellement heureuses d’être maman, quand même”.

La société adore une mère qui pleure doucement.
Mais une mère qui crie, qui explose, qui refuse, là… ça gratte. Ça secoue. Ça met mal à l’aise.
Parce que cette colère dit quelque chose de profondément politique. Elle dit :
“Je suis seule. Je suis épuisée. Je fais tout. Et ce n’est pas normal.”
Et ça, dans un monde où on attend des mères qu’elles tiennent bon sans broncher, ça dérange.
Alors le mom rage, on le planque. On le renomme. On le pathologise. On le fait passer pour une défaillance individuelle.
Mais si on regarde bien, ce n’est pas toi le bug dans le système.
C’est le système, le bug.
Quand la colère des mères dérange… mais arrange bien le système
Imagine un instant une armée de mères fatiguées, en colère, qui disent stop.
Stop à la charge mentale, stop à l’invisibilisation, stop à l’injonction d’aimer chaque minute.
Tu crois que ça passerait crème dans une société qui tient debout (à peine) sur leur dévouement silencieux ?
Pas vraiment.
Une mère qui crie, ça fait désordre.
La mère idéale, dans l’imaginaire collectif, elle est douce, elle s’adapte, elle absorbe.
Elle n’a pas besoin d’espace. Elle ne demande pas grand-chose. Elle donne.
Alors quand elle commence à reprendre, à dire :
“Là, j’en peux plus.”
“Ce n’est pas normal que je sois la seule à me lever la nuit ET à penser aux vaccins ET à gérer les lessives ET à pleurer dans la voiture.”
… ça coince.
Parce que cette parole, elle dérange l’ordre établi.
Elle questionne la répartition des rôles. Elle ébranle l’idée qu’“elles sont faites pour ça”.
Elle montre que non, en fait : la maternité n’est pas forcément douce. Et qu’elle peut être violente, même sans violence physique.

Mais déranger, ça ne veut pas dire dysfonctionner.
Le problème, c’est qu’au lieu de voir cette colère comme un signal d’alerte collectif, on la ramène à l’individuel.
Tu cries ?
Ah, ben t’as qu’à faire plus de yoga.
Ou dormir quand bébé dort (ahah).
Ou “lâcher prise”, tiens. C’est magique, le lâcher-prise, apparemment.
Le mom rage est perçu comme un bug, alors qu’il est en réalité une réponse saine à une situation injuste.
Il est le signal que tu es en train de saturer dans un rôle trop lourd, trop solitaire, trop exigeant.
Mais au lieu de le voir comme un point de bascule, on le traite comme une faute.
Et ça, c’est pas un hasard.
Reconnaître ton mom rage, c’est déjà une résistance
Et si ce moment où tu as hurlé (puis pleuré, puis culpabilisé), ce n’était pas une défaillance, mais une alerte ?
Une manière brutale — certes — mais lucide, de dire “Stop, ça ne peut plus continuer comme ça.”
Parce que le vrai problème, ce n’est pas que tu t’énerves.
C’est que tu portes trop, trop longtemps, toute seule.
Et que tu n’as pas appris à dire “non”, à poser tes limites, à demander de l’aide… parce que personne ne t’a jamais montré comment.
Identifier les déclencheurs = reprendre du pouvoir
Le mom rage ne surgit pas de nulle part. Il a souvent :
- un terreau (la fatigue, la charge mentale, l’isolement),
- un détonateur (le verre d’eau renversé, le refus d’enfiler un pyjama, la 4e nuit blanche),
- et un effet retard (la culpabilité XXL que tu t’infliges après).
Le simple fait de poser des mots là-dessus, c’est puissant.
Ça te permet :
- de repérer les signaux d’alerte en amont,
- de mettre en place des zones tampon (un sas, un relais, une pause),
- et de réintégrer ta colère comme une info, pas comme un échec.
Non, tu n’es pas “folle”.
Non, tu ne vas pas “abîmer ton enfant pour toujours”.
Oui, tu as besoin de soutien. Maintenant. Pas dans six mois.
En parler, c’est briser le silence (et ça, c’est politique)
Chaque fois qu’une mère parle de son mom rage, elle fissure le tabou.
Elle montre aux autres qu’elles ne sont pas seules.
Elle rend visible ce qui est gardé sous cloche dans trop de foyers.
Elle fait un pas vers une autre manière de vivre la maternité : moins sacrificielle, plus honnête, plus partagée.
“Je ne veux pas exploser. Mais je refuse aussi de me taire.”
Cette phrase, tu peux la garder. La ressortir. L’écrire dans ton carnet. L’utiliser comme boussole.

Parce que non, tu ne vas pas “guérir” ton mom rage avec des affirmations positives collées sur le frigo (même si une ou deux peuvent faire sourire, on ne va pas se mentir).
Mais tu peux commencer par dire :
“Ce que je ressens est légitime. Et je refuse d’avoir honte de ça.”
Et rien que ça, c’est déjà une mini-révolution.
Et si ta colère disait quelque chose d’important ?
Tu n’as pas “pété un plomb”.
Tu n’as pas “raté ta maternité”.
Tu as juste atteint la limite d’un système qui te demande trop, sans jamais t’offrir assez.
Ta colère, ce “mom rage” qu’on voudrait te faire taire, il dit quelque chose.
Il dit que tu es humaine.
Il dit que tu ressens l’injustice d’une maternité trop souvent invisible, écrasante, épuisante.
Il dit aussi que tu es lucide, et que tu refuses de continuer comme ça.
Et tu sais quoi ? C’est sain. C’est fort. C’est politique.
Reconnaître ta colère, ce n’est pas devenir dangereuse.
C’est devenir consciente. Et ça, c’est ce qui fait trembler les vieux modèles.
Alors la prochaine fois que ça monte, que tu sens la vague arriver : respire, sors si tu peux, crie dans un coussin, demande de l’aide, écris une note vocale à ta meilleure amie. Et rappelle-toi :
Tu n’as pas besoin d’être parfaite.
Tu as besoin d’être entendue, soutenue, respectée.
Et toi, tu l’as déjà senti ce “mom rage” qui fait peur rien que d’en parler ? Tu l’as vécu comment ? Viens déposer ton expérience en commentaire — ou en message privé si tu préfères. Parce qu’on en a marre de se taire, et qu’on est plusieurs, crois-moi.

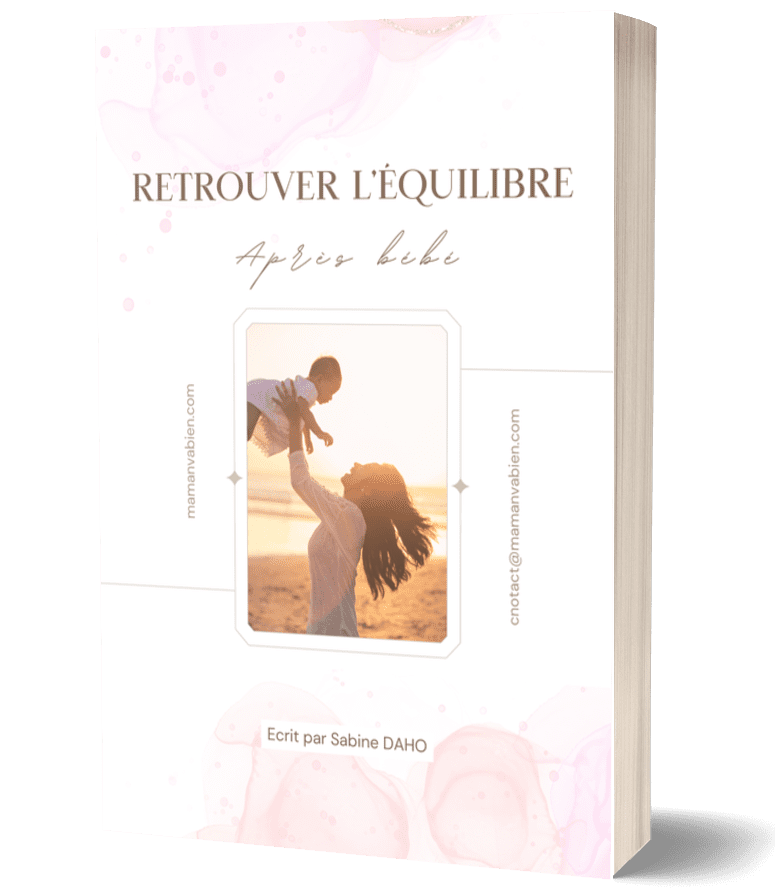
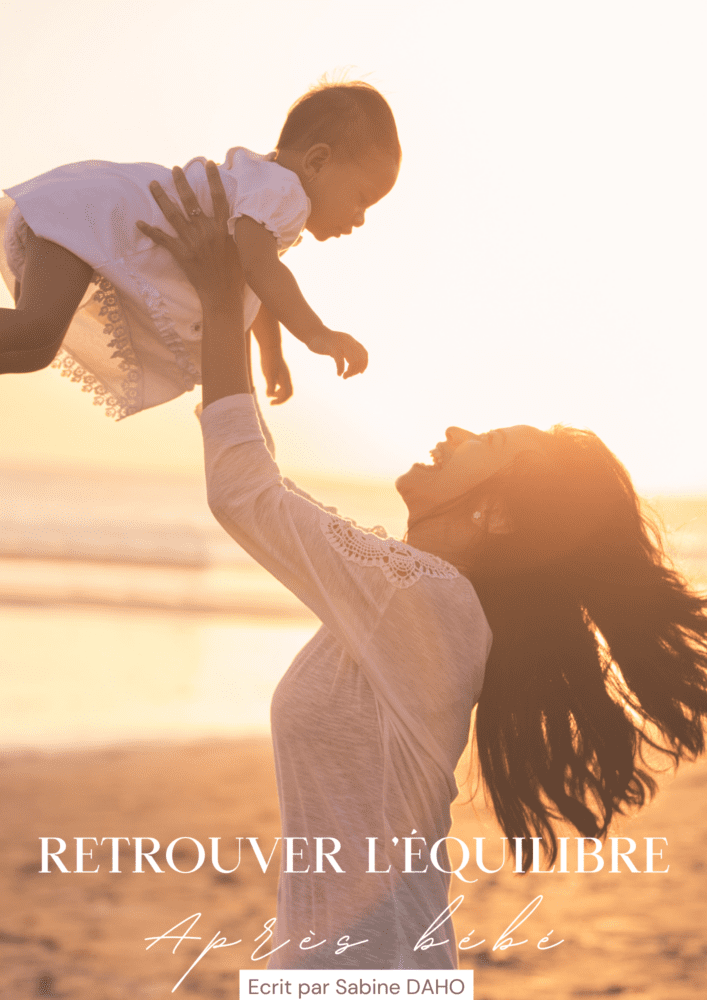

Merci Sabine pour cet article puissant et profondément juste. Tu mets en lumière avec beaucoup de clarté cette colère silencieuse que tant de Mamans (mais également certains Papas) ressentent, souvent en culpabilisant, souvent seules. Même si nos enfants sont grands aujourd’hui, j’ai reconnu des émotions que j’ai moi-même traversées, sans toujours savoir les nommer. Ton regard est précieux, car il permet de remettre cette rage dans un contexte plus large, plus éclairant, et surtout plus libérateur.
Merci pour cette parole qui fait du bien et qui aidera beaucoup de Mamans et Papas également.
Merci beaucoup pour ton joli commentaire Vincent, et pour le rappel que certaines vérités sont partagées également par des papas bienveillants et impliqués comme toi 🙂
Merci pour cet article très intéressant Sabine et d’ouvrir cet espace de réflexion. 🙏
On parle encore trop peu de la charge émotionnelle qui pèse sur tant de femmes, et de tout ce que ça engendre. Ce n’est pas juste une question de fatigue, c’est un vrai sujet de société.
En même temps, la maternité, c’est tellement plus. C’est souvent tout en trop : trop d’émotions, trop d’amour, trop de peurs, trop de joie… et oui, trop de colère parfois. Je crois comme toi, que c’est important aussi d’apprendre à l’accueillir, sans honte, sans culpabilité, comme une part naturelle de cette expérience intense.
Ça donne envie de regarder la maternité dans toute sa complexité et sa richesse, sans réduire les mères à leur épuisement ni nier leur force incroyable.
Merci beaucoup pour ton commentaire Véronique ! Ta conclusion est magnifique : oui, j’invite chacun et chacune à explorer toute la complexité et la richesse de la maternité, qui est une expérience humaine dans toutes ses dimensions ♥